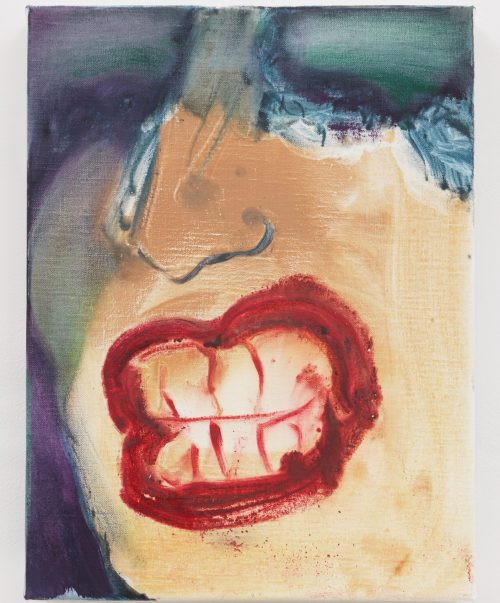As your brest bloom in my hand
there I lay, still and profound.
I take a nap on your skin
before you lap mine.
——————————————————————
Il y a quelque chose à vivre.
Je cours vers un grand lac
Quelque chose d’un lac
profond et tendre
Derrière moi un homme en pierre me poursuit
Je n’ose pas me retourner
de peur qu’il soit vraiment là
Je cours vers ce grand lac
Je m’y enfonce je plonge
Je ne me retourne pas
L’homme reste figé sur le large
Je nage
les montagnes
nous entourent
elles réconfortent le lac
elles le maintiennent en place
et le lac me réconforte
sa paume
épouse
ma peau
Je me laisse flotter
Je prends place au centre de l’eau
J’y deviendrais une île, peut-être
Ou bien l’ayant traversé je rejoindrais l’autre rive
pour voir
ce qu’il y a dans les bois.
(Quelque chose comme ça.)
La Garde
Je me tiens sur un perchoir
pour quand l’aurore viendra je pourrai la voir
et me baignerai le bec dans l’orange du matin
m’enfuirai enfin de ma garde – je l’admets :
je suis en garde, mais bientôt
bientôt
(bientôt!)
je poserai
l’épée
et le bouclier
et toutes mes plumes lourdes
imprégnées de pétrole
au pied de cette branche
pour me déployer dans le ciel,
enfin ! Légère – en ce pâle reflet de l’eau.
A gentle tide – Ann Magill
——————————————————————
Lovée dans les lignes
tristes de ton visage
c’est moi qui pleure et toi qui boit
mes larmes et les essuie.
——————————————————————
Ta main sur mon sein est le jour qui se lève :
la lumière
monte
en moi.
——————————————————————
Falaise-poème : l’orgasme.
le plaisir est grave
quand il est sincère
ample épais et dense
c’est une Falaise
de terre
qui me surplombe
et qui pousse depuis mon ventre,
massive.
Je voudrais me propulser tout contre
y étaler à plat mes mains
claquer cette glaise humide
pour y sculpter quelques visages – le Poème
de cette sensation
insaisissable
qu’est l’Orgasme – un oubli
monumental.
——————————————————————
L’Arbre-Cigogne
Ta main perchée sur un doigt
comme une cigogne en équilibre
qui tangue, et ses plumes qui m’effleurent,
ta douceur,
m’effarent – ne t’envole pas
si vite !
Reste là
Creuse
Prends racine
Deviens l’arbre
Pousse !
Je veux grimper à ton bras
tendu
et m’enfouir à la cime
éparse
de tes cheveux
noirs
pour y frémir à l’abri
– avant d’éclater en averse sur le duvet des oiseaux.
——————————————————————
7,9 x 7,9
Être ce petit carré de ciel
Blanc contre lequel frottent
Ces feuilles
Dessous rien ne bouge comme si
Personne
D’autre
Ne voyait
Ces amants
Là.
Ensuite il a plu.
——————————————————————
Slices
Je découpe
mon cul
en tranches
fines
(slices)
et les dépose
sur
tes yeux.
Ton pantalon soupire.
——————————————————————
Vierge à l’enfant
La lune t’auréole, et la nuit
enduit d’un bleu sombre
tes épaules, nues, et ma bouche
suce ton sein, et tes bras
qui m’entourent me soutiennent
fermement.
Amantes,
nous traverserons les siècles des siècles.
Amarrées
Épanouies
Et confiantes
inspirant bien
quelques idées
de révolution
ici ou
là.
Two woman embracing – Egon Schiele, 1913
——————————————————————
comme un trou dans lequel je tombe encore
j’écris
des mots
qui sont mes lèvres suçant ton sein.
——————————————————————
My girlfriend is a poem
Within, she waves.
Her warm
body slides
around my hand, and I
make her sing
and her song
sounds deep,
and glow.
——————————————————————
Madeleine
Quel est ce goût
de la vie
que j’ai au fond de la gorge
de l’arrière de ma langue jusqu’entre mes cuisses
qui me remplit et qui m’étoffe
quel est ce goût
épais
onctueux
et grave
et chaud
– je lècherai
encore
tes mains
ce soir
tes fesses, ton dos
cette nuit
quel est ce goût
que je bois de ta bouche
quel est ce goût
de la vie
retrouvé ?
——————————————————————
(Une petite chose)
Une petite chose
dont je voudrais parler,
c’est celle qu’est la distance
entre le corps
de deux amant.es
au lendemain de la nuit chaude
– toute petite chose
nue.
——————————————————————
Rester là, pierre.
À l’ombre de ton corps
longtemps
je veux rester là, pierre,
à me laisser étreindre
sans bouger par le voile
qu’est ta peau sur le jour.
Sous moi la terre
se creuse et accueille
mon poids, la mousse
épaissit
le silence, et m’apaise.
Le frisson
dense
de la vie
sourd.
Un éclat de lumière
sur ma peau :
c’est ta bouche, la rosée.
Roche embaumée
de musc, je m’endors
– là.
——————————————————————
Haïcul
Oscillant autour
d’un cri humide, mes doigts,
enfin s’y enfoncent.
——————————————————————
Je m’enfouis dans ton cou
à défaut de m’enfuir
dans ton corps
– je veux courir à perdre haleine
et déchirant tous mes vêtements
franchir les branches de tes poumons
prendre appuis sur tes os
de la plante de mes pieds nus
pour plonger dans tes muscles
et battre (cadence folle – dents bras mains cuisses)
battre ton sang.
——————————————————————
Mer d’août
Marcher nue dans l’eau
l’été
la nuit ma peau la douce
brise et le silence
autour.
L’une ou l’autre épaule
se dépose en épice
sur la mienne
salée
et la lune de lait
nappe et enduit
d’indigo les ondes
qui s’enfuient
de nos corps
vers la rive
– nos soupirs.
——————————————————————
Nouveau jour.
Accroupi au sol et suspendu, son souffle,
un corps vacille à peine, sorte de caresse
métronomique et inspirante.
Je suis la peau de quelle ombre ?
Sa question vibre au long des herbes moites
de rosée et des racines.
Autour de lui les pins trempent dans le ciel
statiques ainsi qu’en l’océan
peuvent l’être les algues,
pinceaux piqués d’aurore :
Le jour se lève, femme paisible
qui a acquit la grâce des âges et sait
qu’elle a le temps de le faire.
Immergés, ondulent sous les courants
d’air – chauds, froids, chauds, froids –
et ce corps, et ces arbres, et leurs ombres – bleues.
Noués au sol, à l’horizon rivés,
ils tiennent le monde assemblé
et appellent, imperceptibles,
d’une danse un nouveau jour.
——————————————————————
J’avais l’œil courbé à la ville
– me suis soudain souvenu du ciel
immense
infini temps qu’il faut pour l’appréhender
suis souvenu des marins dont on m’a dit l’œil fou
de l’avoir trop sondé,
indissociable d’eau.
Ciel oublié sur la ville un matin m’a sauté aux yeux.
Depuis je traverse les rues comme l’œil se perd sur l’océan :
avide, ouverte
le regard ivre
de tant d’espace
appelant au vaste
comme une bouche d’enfant un sein
– l’œil fou d’avoir manqué le ciel
si longtemps
plein d’espoir où tout prend sens
et tout s’oublie
– fou de voir tranché l’horizon,
à la recherche, éperdu,
d’un signe
au loin.
——————————————————————
Marco
Ta peau tannée
Ton nez tapis
Ta pisse tiède
Tes dents – tanin.
——————————————————————
Même vêtue
nue dans les prés nue contre toi nue sous tes doigts nue dans la rue nue sous ton cul nue dans la douche nue dans ta bouche nue dans ton cul nue sous la pluie nue dans un lac nue sans reproches nue déjà vieille nue minuit sonne nue dans tes yeux nue sans personne nue sans bouger nue vers le soir nue le matin nue le lundi nue au bureau nue chez les flics nue à Noël nue en voiture nue chez Truffaut nue au cimetière nue dans tes bras nue sous tes dents nue chez le dentiste nue en manif nue sous tes pieds nue bouche ouverte entre tes cuisses nue sous la neige nue en montagne nue sous la mer nue crue dans ton plat nue à cru sur un cheval nue dans les cuisines nue à l’aéroport nue à l’apéro chez les voisins du deuxième nue à la boulangerie nue dans la station vide nue en Amérique nue sauf mes lunettes nue sous ta fenêtre nue pleine de paillettes nue sur tous les toits nue derrière ma guitare nue à l’harmonica nue au cinéma nues mes fesses nues mes jambes nues mes joues nues mes obligations nus mes devoir nus mes désirs mes désirs mis à nus mes secrets mis à poil et nus mes poils nu le halo lumineux de ma peau la nuit nue dans le ventre de la baleine nue dans le silence nue sur la piste de danse nue sur des patins à roulette nue à la roulette Russe nue sous les étoiles nue sur le parquet ciré nue sous mon ciré nue sous les fauteuils nue dans la salle d’attente nue dans la poussière nue face au miroir nue derrière le comptoir nue accoudée au bar nue contre le bar nue contre la vitre nue contre le mur nue contre le lit nue contre l’armoire nue contre le bureau nue contre la baignoire nue contre la rambarde de l’escalier nue contre la table de la salle à manger nue contre l’évier sale nue contre la porte d’entrée nue contre le portail nue contre un lampadaire nue contre l’arrêt de bus nue contre le bitume nue contre les roues des voitures et je les mords nue contre ton corps nue contre ton corps nu nue toute la journée et toute la nuit nue – toute la vie, même vêtue, nue.
——————————————————————
Je m’en souviens
Je m’en souviens, ton corps
m’embrassait toute entière
il me débordait
des yeux
pores et puis la bouche
il suintait
de ma pensée
et j’irradiais ton odeur
sans même jamais t’avoir touché.
——————————————————————
Mois
Je déverse mon sang sur la faïence
Blanche :
il se délasse, pas pressé coule
onctueux, nappe la vasque
Pâle
de tout son corps épais, de ce
Rouge
presque
Noir
et qui me nargue.
Tous ses yeux
Vifs
ont le reflet
Net
des néons
Bleus
et je me vois
lentement
étirée
vers le métal
Vert
de
Gris
du siphon
Vide
et
Rouillé
qui m’aspire
et qui me boit.
Ce mois encore je dégouline vers les égouts.
——————————————————————
Bain – autre prière
Le ciel – mais on est dedans sans le voir !
Il épouse la Terre avec exactitude
Effleure le contours précis de la montagne
Et se laisse émouvoir par le remous des vagues
Et plonge dans les vallées
Et même dessous la terre.
Enveloppés de ciel, il n’y a pas d’interstice
Entre nos peaux : on baigne.
Trempés de ciel, même nos cils
S’y glissent, et fouettent, quand sur nos yeux
Il repose – et parfois
lors d’une seconde très précise, le pied
y prend appui quand il se lève
lors de l’élan.
Je ne veux plus croire à l’horizon
Puisque je sais qu’il est partout,
Le ciel,
Entre cette ligne et mon œil, et même autour ! Et même après !
Non, je ne veux plus de l’espoir
– qu’il ne me reste que le présent.
——————————————————————
Comme un arbre gelé je médite
Une blanche
parure s’empare de moi, je scintille,
dépouillée du feuillage qui
obstrue mon regard,
empêche ma vision,
je touche enfin le ciel,
plein et
enveloppant.
Vêtue de givre,
suspendue,
comme un point après l’ordre des mots,
juste au moment que
l’encre
se diffuse
et que se relève
la pointe
du stylo
– éternelle un instant,
précise.
——————————————————————
Page précise
Tu es une page dans un livre que j’ai lue il y a longtemps.
Je te recherche.
Je ne l’ai pas cornée.
Je feuillette.
J’ai l’illusion de croire
qu’il y a un mot très précis
– dont je ne me souviens plus vraiment –
grâce auquel je te retrouverais
– me manque aussi le nom du livre.
——————————————————————
Haïcul
Quel étrange anneau
que, nu, ton corps à mon doigt.
Notre lit : l’autel.
——————————————————————
L’énigme me mange.
Je ne serai pas une reine.
J’ai une énigme à résoudre et qui me rendra la sensation de voir – sans doutes.
Je laisse mon enfant pleurer c’est pareil que s’il ne pleurait pas et ce n’est pas le mien non plus.
Mes seins sont des pyramides aux pointes pourpres où les époux se perdent au moment du voyage de noces.
J’ai un cahier de peau que tu laves tous les jours et que tu rases pourquoi mon amour.
J’écris des chansons pour comprendre ce que ça fait de chanter.
J’ai maquillé ma langue elle m’étouffe – son boa et ses perles.
Mon enfant pleure je le regarde je le vois pas.
Le sable et le lait se mélangent sur mon torse j’y vois la trace de tes semelles.
C’est une boue crème.
Je la lèche.
Je bois mes seins.
Ma langue se perd dans ses plumes.
Mon cahier a des bleus.
Je ne serai pas une reine.
Je suis trop sage pour parler de mes entrailles.
Il y a un mort sur mon frigo.
Mes entrailles se saisissent elles entendent mon petit pleurer.
Je me sens une énigme.
Je ne me suis pas résolue.
Mes côtes n’ont pas révélé leur trésor.
Elles n’ont pas ouvert leur coffre éclairé les pirates autour.
Je suis un vieux galion.
Quand l’extérieur de mon corps craque je me mets à trembler.
Mon ventre dit que c’est mon fils à moi qui pleure.
Mes tétons brûlent au frottement du sel sur l’eau.
J’avance vite je le fais pas exprès.
Ma langue travestie transpire des aisselles et chaude se colle à mon palais.
Elle gonfle.
Je m’accouple aux coquillages sur ma coque et je n’ai pas d’enfant.
Je chante pour m’endormir mais je ne sais pas si c’est vrai.
Il n’y a aucun indice.
Pas même un petit qui se calmerait.
L’alarme est là depuis le début qui clignote mais l’incendie ne se déclenche pas.
Et personne ne rentre.
Plusieurs nœuds me séparent de la côte.
Je préfère écrire des poèmes que de nourrir mon enfant.
Mais pourvu qu’il se taise.
Je ne chanterai pas pour l’endormir.
Mes mains sont remplies de sang je ne les ouvre pas je le garde.
Il n’y a pas de preuves.
Hormis les vibrations.
C’est moi qui chante ou c’est lui qui pleure ou bien c’est le courant.
Et mes côtes qui se nouent.
Elles ne libèrent rien.
Les insectes m’ont déjà trouvée.
Ils boivent le lait pâle sur mes seins.
Je suis une corde tressée.
Je suis toute nue.
Je ne sais pas si je suis habillée ou non.
Je ne fais pas exprès d’avancer.
C’est le courant ou c’est l’air qui sort de mon cul.
Je n’ai pas mis pied à terre depuis cinq ou peut-être sept ans.
On m’a roulée hors de mon lit.
Et les mains qui se sont posées sur moi ont collé à ma peau et en ont arraché des bouts.
Quand j’aurai soixante ans tout pourra commencer.
J’ai bientôt soixante ans.
Je n’ai rien d’autre à faire.
Je n’ai rien à me mettre à part mon corps.
Je pose mes mains sur des visages.
Ils disent que je les ai posées.
Je m’en souviens comme si c’était hier alors que c’était aujourd’hui.
Je craque.
J’ai des trous dans le plancher.
Les coquillages sur ma coque sucent mes seins et je fuis.
Je laisse des traces blanches dans l’eau c’est mon sillage.
Je n’en peux plus de tout ce sel.
J’ai déjà presque soixante ans.
Je grince entre l’air et l’eau.
Des requins suivent ils sont déçus.
Je ne me noie pas ni ne saigne.
Je garde la ligne.
Je reste nouée.
Je voudrais me faire dévorer.
Et d’un coup résoudre l’énigme.
Et passer au niveau suivant.
Mes côtes s’ouvriront.
Portes d’or pixels jaunes un message surgit comme un arc-en-ciel au fond des yeux.
Les requins chantent.
Ils m’accompagnent.
L’île apparaît.
La pyramide.
Un frigo pend entre les lianes.
Il n’y a plus d’enfant ni de mouches.
Ni plus d’époux.
Je me glisse dans la plage.
Je suis une paisible croûte de sel.
Mes entrailles fondent avec l’extérieur.
Je ne suis pas une reine.
Je suis un banc de sable.
Les grains dedans et dehors ce sont les mêmes que ma peau.
Je n’ai plus besoin de bercer personne.
Je peux enfin chanter.
J’écris des chansons par frissonnements dans le sable.
Elles sont des prophéties.
Elles se réaliseront.
Je dors contre le ciel.
Je dors contre ta peau.
Je dors sur mon carnet.
Et je grince.
En bas.
En haut.
Je n’ai pas soixante ans.
Je n’ai ni le droit du feu ni celui des entrailles.
Je vomis dans mes mains.
Je perds un peu de sang.
Et personne ne le lèche.
Et l’énigme me mange.
– c’est elle qui me suce.
——————————————————————
——————————————————————
What is left
what is left of our love :
a pile of our clothes
– the only gathering is
the dust.
——————————————————————
Paul et Louis
La meilleure partie de la poire c’est ta peau
dit Paul en léchant la pulpe
de ses doigts, la langue
pleine et très lentement.
——————————————————————
Voiles
nos lèvres gonflent
à toute vitesse
et elles s’embarquent
vers
le large.
——————————————————————
(autre sorte de silence)
Si c’était pour te faire taire,
je n’aurais pas mis mon doigt
entre tes lèvres – mais bien dessus.
——————————————————————
Une odyssée : orgasme orage – pleine mer, puis rive neuve.
I.
On fait l’amour sans un bruit
sans un bruit sans plus un bruit
– on se retient
on se tient les corps serrés si serrés qu’on jouirait d’un seul geste,
mais on tient on se retient on se tient et on ne bouge
pas.
Comment la pièce peut-elle avec nous supporter ce silence
si intense
Comment peut elle
seulement nous contenir
Comment peut elle avec nous s’empêcher
de crier d’éclater se disloquer – heureusement que tu me tiens
et que moi aussi je te tiens
et je te jure que tu ne bougeras pas, je te jure
que si tu bouges je crie.
Nous sommes rivés si forts ensemble, denses et immobiles quand soudain
un léger tremblement
monte – il arrive.
Malgré nous
une secousse infime et qui n’en finit plus d’être légère et délicieuse
irrépressible
insupportable de délice nous inonde se répand et on ne peut plus l’arrêter – je te jure
que je ne peux pas l’arrêter.
Un tressaillement imperceptible yeux dans les yeux c’est en dessous que ça se passe c’est en nous à l’intérieur c’est déjà trop et c’est trop tard on se resserre on se serre presque horrifiés et ça nous monte nous envahit nous on veut s’empêcher de jaillir on s’accroche on bouge à peine on lutte on se resserre on s’enserre on se serre plus un espace entre nos corps on essaie de tenir de contenir de retenir de soutenir
cette intense
sensation
qui monte
s’il te plaît
on tient
si on se lâche on se noie
je te jure
on va se perdre
attends
s’il te plaît
je vais me noyer
c’est trop
s’il te plaît
Attends !
– c’est trop tard.
On se noie.
II.
On crie.
On se noie.
On se débat. On se perd.
III.
Ensuite évanouie dans le sentiment immense d’une étendue déserte et molle.
Ensuite étalée seule si vaste et pleine de ce plus rien n’a d’importance et tout est bon.
IV.
Je sais que tu es toujours là.
Un réseau précis de fibres fines douloureuses
et palpitantes
m’attachent encore à toi.
Si tu bougeais
si tu faisais un seul mouvement
si tu pouvais encore faire un seul mouvement
vers moi
sans doute que j’en
mourrais
encore.
Est-ce que j’ai dit tout ça à voix haute ?
Est-ce que je sais encore parler ?
Grésillent mes lèvres et ma gorge,
ligne directe et large vers
mon sexe
brûlant. Le filet de plaisir
dans lequel je suis prise continue de
trembler sur
et sous
ma peau, me cisaille
et c’est encore bon. Ta peau
proche et lointaine
continue
d’émaner
une chaleur
qui m’attise. Et si tu touchais mes seins
(pour voir si je suis vivante)
Si tu effleurais mon sexe
Si tu soufflais sur mon épaule
Si tu apercevais à peine
le pli de ma paupière
l’attache de mon lobe
l’aigu de mon oeil
l’arrondi de ma joue
ou le grain de ma gorge
Ce serait ma fin.
Moi déjà
je ne suis plus rien
je n’attends plus rien
je n’entends plus rien
je ne veux plus rien
je ne sais plus rien – d’autre
que palpiter
entrouvrir
un œil,
ou
déplacer
mon bras
d’un
si
petit
millimètre
que c’est déjà
trop
de caresses – je te jure
que j’en jouirais
encore.
Est-ce que j’ai
dit
tout ça ?
À voix haute ?
Est-ce que je pourrais encore jouir
un jour ?
V.
Ensuite étendue nue auréole pâle et silencieuse
d’un silence neuf et élargi.
Ensuite picorée par les mouettes sur la rive,
je revois le ciel et je respire
encore – ce mot là, oui –
et j’ai envie alors – je l’ai dit, oui –
de tout recommencer, oui – à voix haute.
Lac.
Tu me touches
– là
et je change d’état je deviens
liquide
élastique et souple
Onctueuse
– lac.
——————————————————————
Dernier contact du jour.
Intense le soleil se jette
et fouette
la poitrine – émouvante –
des montagnes.
Il dégouline à son sommet
Enlace l’amont
Lèche
de sa langue chaude la crête
souple
Et avale – vague
de chaleur et de lumière –
les rochers
qui soupirent
et se tendent.
(Au matin,
on les retrouvera humides mais ce soir
Ils brûlent
au dernier contact du jour.)
@jaune.illustration – avril 2021
——————————————————————
Haïkuphène
Après tant de cris
Le silence existe-t-il
Encore ? Oui – en moi.
(paix.)
——————————————————————
Au bout de ma peau ta bouche,
Au bord de ma bouche ta peau.
——————————————————————
Mais où est passé mon orgasme
je l’ai perdu
entre des images et mes doigts
il a filé sous mes draps
sous mon nombril humide
et déjà
je l’oublie – il ne me reste que ces visages
d’inconnues et nues
ces femmes
qui continuent de jouir
sans fin.
——————————————————————
Mon regard contre ta bouche est un gland qui perle
et toi tu viens lécher cette goutte – oh,
bois-moi.
Être saisie
par le réel
comme sur le feu
comme entre deux mains fermes
comme jetée dans une eau bouillante
Saisie
voir apparaître
par d’autres contours les miens
comprendre cet état
que je suis
me révéler tangible
Être saisie
et saisir
ce que je suis
par le feu
dans l’eau ferme
deux mains bouillantes
irréelle.
——————————————————————
Des fils d’or bruns flottent
entre tes cuisses,
éparses, évanouis
– tu as noyé ton sexe,
Ophélie.
——————————————————————
Haïcul
Mes doigts se recueillent
en toi, silencieux ils font
le deuil de ton cri.
——————————————————————
L’embrume
Nue dans le soleil je n’arrive pas à m’éveiller
Tout est un rêve et tout est vrai – c’est moi
Qui suis la frontière
Moi qui suis la réalité :
perdue.
——————————————————————
Sein apaise, nouveau jour.
Mon amant me berce, mère
au sein vide mais d’envie
ma bouche
ne le lâche
pas.
Entrouvertes mes lèvres
cherchent
avides
le téton, sa chaleur
me nourrit – et je te mords un peu.
À la moiteur de ton ventre je retrouve
le corps
lourd
d’une enfant, rassasiée,
et m’apaise
avant de m’éveiller nouvelle – ainsi m’enfante
mon amant.
——————————————————————
Creux du monde – mon coude.
Le soleil neige
sous nos pieds, les arbres
aussi
j’ai basculé, le monde
m’apparaît comme
tout autre – c’est ta main qui fait ça,
au creux de mon coude ?
——————————————————————
En brasses
En brasses coulées mon regard
s’éloigne
toujours plus de la rive – ma raison –
à travers champs
vents et marées
de l’esprit.
Je bois la tasse mords la poussière
des idées
– ces souvenirs
de nous
que je n’aurais
pas !
Mes pensées se sont pris le train
Elles se répandent en coquelicots le long des rails.
Nue, je vais et je viens sans but. Je suis une âme en peine, je suis un ventre perdu. Je le cherche, je l’appelle et sur ma croupe souffle et siffle le vent du nord.
Ravages – Violette Leduc, 1955.
(à nouveau, l’été, attendu.)
Je ne tombe pas dans ton corps comme une pierre dans un lac.
Je reste au bord, je tremble
de désir
Bleue de désir
n’osant pas cette fois encore
y plonger – caresser d’ondes la surface
de ta peau, puis l’agiter
depuis la lente profondeur
de ma chute
– je reste contre toi comme un caillou tenu par la main d’une enfant.
Origin of the Universe 1 Mickalene Thomas
Corps
chemin en perspective
dont le tout petit point de fuite
est au centre : il irrigue
tout le dessin.
j’ai la joue du ciel sur la mienne
– Violette Leduc , La folie en tête.
(Ciel et Mer – Emil Nolde, 1930)
La plus fine couche et la plus extérieure.
Je crois bien que des étincelles
font le lien entre
la plus fine couche
et la plus extérieure
de nos peaux :
on s’effleure
jusqu’à la brûlure.
Jmxplr
Je m’explore comme j’explore
la vie
avec plus ou moins d’audace selon
les jours
ou la compagnie.
[plus jamais]
Ce moment précis, terrible et tendre
Où je sais que je ne t’aime plus :
« Ça y est, c’est tout,
C’est fait
Nous nous sommes aimés et c’est fini. »
Je te prends encore dans mes bras
J’enfonce mes doigts dans tes cheveux
Tire ton visage vers mon visage
Et plonge mon regard, dur, dans le tien.
Et tu le sais, et on se tait,
Précis, tendres et nostalgiques
On se caresse encore
Avant de ne plus jamais se toucher.
Est-ce que nos rêves aussi
essaient
de se souvenir de nous ?
Étendue au jour
Un rai de lumière entre mes cuisses nues
– avec l’ombre de mes doigts
je viens l’agiter :
chaud
froid
chaud
froid.
Épuiser le ciel
et la terre de ma présence
être une jonction
un tunnel
un autre de ces corps
– un arbre, une pierre, ou une mare –
par lesquels le ciel
pénètre la terre et la terre
pénètre le ciel,
par où ils se renversent et par où ils
s’enfuient.
Dans la terre il y a
l’eau, le feu,
et dans le ciel aussi, à travers moi
les éléments circulent
Tous
me constituent
Et ils me prennent
Et je me donne.
Contempler la vallée
Haletante je gravis
la pente
érogène qui s’élève
de ton épaule à ton visage
en passant par ta gorge :
ton cou.
Épuisée je m’arrête là
un instant, contemple,
émue, le paysage
humide de ton ventre, des ruisseaux
d’argent le parcourent ; de les voir je me souviens –
leur fraîcheur quand je m’y suis baignée
les remous de l’eau suçant mes hanches
le courant léger enroulé à mes jambes
et comment le soleil
m’a séchée sur la berge ;
comment nue j’ai repris ma route
pour me retrouver là – juste au bord de tes lèvres …
Un vertige me saisit d’avoir osé trop longtemps
contempler la vallée –
elle m’aspire je m’accroche
à ce que je peux, mords
l’arrête d’os de sous ta joue, empoigne
de tous mes doigts tes cheveux,
bien fort – tétanisée je ne peux plus
faire un seul pas quand soudain
un profond frisson
m’éprend : la montagne
ouvre ses bras
elle m’attrape
elle m’étreint
et m’incorpore
et je deviens
Le lierre
embrassé au rocher !
(une année moite s’est écoulée, merci de vos présences.)
(haïcul)
J’écris sur le tien
Le mot sexe à la langue
-Soudain tu gémis.
Abandonner mon corps
et que quelqu’un le recueille
– me prenne dans ses bras.
« Je me sens comme flottant dans le plasma. J’ai besoin d’un professeur ou d’un amant. J’ai besoin de quelqu’un qui prenne le risque d’être avec moi » – Francesca Woodman.
Intermède
Tu t’endors
comme une vague
se retire de la plage,
dans un grand souffle et puis
ne reste que le silence
du sable humide qui crépite – nos draps.
J’y reste seule,
la peau salée,
y plonge mes doigts,
sèche mes seins, attends patiente
que tu refasses
surface – sur laquelle déferler.
——————————————————————
La Déception de l’Amante
« Je sais
j’ai pas
le monopole des seins. »
Folie de femmes
Une folie de femmes païennes s’agite
seins par-dessus tête bouches
grandes ouvertes
en un long chant qui est un cri
de joie ça jouit
de partout
elles ondulent – mains coudes épaules gorges ventres genoux – leurs torses
luisent et le soleil
les cuirasse elles tremblent
de tant de chair vivifiée
nues
adorées
exaltées d’espace et d’ensemble
c’est une naissance, c’est une jouissance, c’est un cri –
Être là !
tbchtb
Ta bouche est tombée sur mon sexe
ce pétale
me réjouit.
avec toi, c’est le fruit qui me mange.
Fonds-toi.
Fonds-toi
ma douce
au plus profond
de mon être
coules-toi
amour
entre tous mes
recoins
viens
s’il te plaît
rigoler entre mes os !
Vis d’aller danser.
Nouvelle envie
vie
d’aller danser
é
-brouer mon corps
or
couler mon dos
oh
rouler mes poings
seins
contre le vent
– sens !
Envie d’achever le cheval indien.
Nouvelle envie
d’aller danser
c’est
pas difficile
île
suffit d’être bien
loin
gorge déployée
bée
souffle coupé
é
paules pliées
et
rythme tordu
– dupliquer la frénésie des flammes éventails.
Envie d’aller danser
danser surtout les pieds nus
surtout les pieds sales
surtout les pieds flous
surtout les pieds creux
surtout pas stable surtout
pas stables les pieds
les pieds qui dansent
les pieds qui dansent les chevilles qui dansent
les genoux qui dansent les hanches qui dansent
les hanches qui dansent la danse du ventre
que la poitrine danse mes seins
que les épaules dansent la danse du ventre du visage
la danse du ventre de ma bouche
la danse du ventre des racines
de mon cuir
tout chevelu qu’il soit
qu’ils dansent tous
que mes doigts dansent
mes poignets mes coudes qu’ils dansent
qu’ils dansent celle des enfants évanouis.
– vas, vis et deviens d’aller danser.
De ton regard et de cette horde (nos corps)
Je gémis et tu m’embrasses
Tu gémis et on s’embrase
– mais comment faire pour se défaire
de nous
je pense
soudain – on s’écrase
encore
on s’écoule
encore
hors dans et sur nos peaux
se répandent
notre salive et des caresses mais comment faire
pour se défaire
un jour de nous je pense
Tandis qu’on se déferle
l’un sur l’autre
qu’on se ravage et qu’on s’engouffre
encore une fois
hors dans et sur nos peaux
vives et brûlantes de l’empreinte d’une horde
– nos mains, nos cuisses, nos joues –
qui trace la route à suivre vers
l’oasis et moi d’un coup je pense
à comment un jour s’en passer –
de nos mains cet oasis à nous cette horde nos corps-
parce qu’il le faudra bien puisqu’on sait rien faire d’autre
que s’aimer mais s’aimer comme ça
n’est pas assez puisqu’on ne s’aime jamais autant
que quand on ne se comprend pas c’est épuisant
à la fin
– tu m’épuises !
À côté de toi moi je dors plus, je ne fais que trembler
cherchant, subtile, à effleurer mes fibres
de tout ce qui fait ta peau
voulant moi que tu t’éveilles
tout contre mon corps par hasard
chaud
et puis mon corps tu sais je sais
même plus comment le vêtir
d’autre chose que tes yeux
– me ballade sans cesse nue, c’est indécent,
dans la rue, brûlante, épuisée,
et on me jette de ces regards
qui savent pas m’habiller comme le tien
Je reste nue
et ton regard
– j’ai trop d’orgueil pour y renoncer vraiment
et trop d’ambition pour m’en satisfaire pleinement
De ce regard qu’est ton regard
mais qu’est-ce que c’est que ce regard !
Qui fait fleurir mes seins comme ça !
S’épanouir en corolle ma poitrine long de mes bras jusqu’à même mon ventre et mes talons !
Éclater mes tétons brûlant et qui se tendent rêvant d’atteindre
ta bouche ! Mais qu’est-ce que c’est
que ce regard qui fouette mes mollets gonfle mes lèvres et les laisse prêtes à exploser !
Sais plus quoi faire de ce regard là, tes mains, ta poitrine,
faits d’une douceur insolente et qui semble sans fin et qui m’épuise – je te jure
ça devra bien finir un jour mais comment faire
je pense
il va bien falloir faire quelque chose,
s’en sortir ! de nous deux – juste avant que l’oubli
intense
ne m’avale – notre oasis.
Alexandrin
Briser l’ordre établi de ta main sur mon cul.
2014 – Manifeste adolescent.
Tous prenaient sens à être ensemble.
Se coulaient de belles paroles. S’aimaient à demi-verre, s’embrassaient à verre vide.
Sourires calmes et pleins au petit jour.
Éclats de verre sur un sol collant de cuisine, et de rires juste au-dessus.
Si les petites filles pleuraient, celles qui se sentaient grandir parlaient trop fort en agitant leurs cheveux. Les femmes doivent si bien savoir le faire, bouger leurs boucles (et capillaires, et de ceinture).
S’écouter était devenu trop simple, maintenant on se devinait en se devançant.
Coulez, tonneaux ! Et que la mer vienne nous prendre.
Nous, nous sommes déjà un radeau. On trouvera les voiles, larguez les amarres.
On croque le gâteau sec, et le ver qui est dedans.
Les joues rayées, les pulls rougis, on se titube à cœur ouvert
et en plein jour on sait s’aimer
à cœur perdu.
Les silences ont pris leur sens, ils l’ont trouvé le long des rives.
Nos souffles -hisse- et nos frissons -ého- parcourent l’échine des chevaux faibles et embrigadent les fourmis.
On chantera tous les étés, on dansera tous les présents.
Aussi tristes que des clowns bien maquillés, aussi sereins que les capitaines.
Voyez la robe de la belle Margot, elle a enchanté le cœur de tous nos hommes
– ils en reviennent fiers de tant de prouesses.
Ce qui est simple se déguste, ce qui est dingue s’extasie, et ce qui tombe va dans la sienne.
Assiette creuse et bien remplie, on sait jouer l’air de la nuit, les balançoires savent se taire à l’approche d’une telle armée.
Furie ! Tourbillon !
Dieu, qu’ils sont beaux ces petits frères.
Donner du sens à l’Être Ensemble.
Donner du goût à nos langues cendrées.
Se mordre les joues en présence des tiennes, tout ça c’est devenu la norme.
Norme des prés où l’on va se rouler, norme des flots où l’on peut que voguer, norme des rues qui toutes nous appartiennent.
Au clair de la lune on les entend chanter, tous ces petits êtres qui se sont trouvés
Mieux que des loups pire que des hommes, ils suivent le pavé comme une foule en liesse
Savent se taire pour mieux rigoler, et pleurer fort sur la bonne épaule.
Vide ta fiole et avale tout, pas de temps à perdre ici mon ami – car tout se gagne là.
La lune ronde sait nous attendre
et bien souvent nous accueillir
Nous sommes aussi chauves que des barbus
aussi silencieux que des amants – on débarque !
Grands.
Joie dans les estomacs, chansons dans les poitrines, les sexes s’enivrent d’une menteuse chasteté.
On croirait renaître à chaque regard.
De la confiance dans leurs pupilles, de beaux secrets, de terribles mensonges sous les dents – qu’on les arrache, nous ne dirons rien.
Solidarité ! Et à soi-même tout autant !
Les hommes rougissent et les femmes se grattent le cul
ici ni haut ni bas
juste l’éphémère infini qui nous enserre les côtes à nous faire tourner.
Encore une fois des fenêtres se ferment à leur passage, des plaintes tombent et «la maréchaussée vaincra !»
Seulement tous oublient quelle est l’ampleur du phénomène : ce n’est pas humain.
Nous sommes ontologiques, essentiels, terribles et immortels.
Nous scellons ce qui n’a de cesse de se sceller.
Nous pactisons avec ce qui a été fait et ce qui adviendra – indubitablement :
la jeunesse, la joie.
Toujours le torrent trouve la faille.
Nous sommes élémentaires, nous créons le socle.
Amis, nous buvons le feu, respirons l’eau, creusons l’air – et c’est nous qui brûlons au centre de la Terre, ce qui fait qu’elle tourne.
Jules Verne est venu jusqu’à nous, ne nous lassons pas de nous laisser écrire.
Nous appartenons à ce temps parce que nous appartenons à ce qui vit et se déploie.
Tous prenaient sens à être ensemble, mais ils étaient seuls à l’avoir compris.
Prêchons, mes bons amis !
La bonne parole est dans le martini, mais surtout aux lèvres de ceux qui passent la bouteille.
Tant qu’ils tiendront debout, les braves seront l’âme, il n’est pas besoin de mourir pour la laisser s’élever.
Si nous avons l’air d’errer nous ne faisons qu’aimer :
tous, Hommes, nous prendront sens, Femmes, à être ensemble.
Ta main est un regard perdu
Elle est toute ta peine
Museau humide
Qui vient éveiller sa maîtresse
Par vagues elle me lèche
les côtes
ta paume
Et m’épuise
déjà.
Plein soleil
Les petits points qui sont sur mes yeux
dansent dans l’espace
et les murs ont bleui – j’ai dormi trop longtemps.
Comment vivre
après certains rêves
puisqu’alors on a
comme déjà tout vécu ?
Au final
et pour l’instant
la vie
est plus forte que le rêve
– elle ne s’arrête pas.
(patience.)
Rosé d’été
Je me suis endormi dans un champs
chaud comme une bouche
il m’a sucé le cœur et maintenant
trempé, je grelotte.
Msjsv
Mais si, je suis vêtue !
regarde
de quelle étoffe ils sont faits,
mes seins.
Où je me déclare romantique et perdue, sous-bois éperdu, florissant.
Le poème de ta bouche, inépuisable et
incompréhensible
m’obsède et j’ai beau
le connaître sur le bout des doigts
du bout des lèvres et de la langue
je ne peux pas le dire.
Il me reste, magnifique et troublant,
au travers de la gorge
où il pulse, la nuit, le jour,
diffuse en moi ses vers
Abondamment
s’enracine.
Je les connais par cœur
ces vers
tes lèvres
qui me dévorent
que je mange – et toute ma chair
grouillante
est mue par ce poème
– qui me laisse sans voix.
Il pousse dans mon ventre
– je ne peux pas le dire.
Il puise mes genoux
– je ne peux pas le dire.
Il frémit sous mes seins
– je ne peux pas le dire.
Il sourd à mes yeux
– je ne peux pas le dire.
Pétrifiée par
tant de beauté je
me décompose
en
petit
tas
de terre
meuble
humide
fraîchement retourné
ému
et les entrailles à l’air
– toi tu y plonges encore les doigts !
comme dans du café fin, moulu
par
les aubes de ta voix.
(Si je pleure j’espère
que la boue sur mon visage
ne fera pas ta bouche se déplanter de là.)
Comment dire qu’à tes lèvres
tremble
le plus beau poème
qui ait jamais été dit
et ne pourra se dire – que s’embrasser.
Tu ne cesses
d’y ajouter des vers, chaque seconde
de vie glisse
sur ton visage
de nouvelles richesses
jusqu’alors inconnues – mais du monde lui même !
Encore un vers, je pense,
que je ne peux pas dire
et qui me mange la bouche,
prend racine à mon ventre…
Tu m’embrasses, tu te déposes
sur moi comme une feuille
morte se mêle à l’humus
– à moitié transparente, sa dentelle avouée –
tu fonds
en moi
le limbe
de ta peau.
(Ma bouche
bientôt
célébrera ton poème
d’un arbre – ma bouche,
d’où il s’élèvera.)
Si seule
Au corps à corps
lutter avec l’abandon
Seule, j’y plonge
– si seule que j’y plonge.